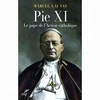Nos coups de coeur

« On repasse les séquences d’archive : la submersion migratoire de l’Europe, les médias prônant l’accueil et la tolérance, les politiciens supputant le nombre d’arrivants dont le Vieux continent aurait besoin, cinquante millions, cent millions (…) Les fonctionnaires de l’antiracisme fustigent les « idées rances » de ceux qui s’accrochent à leur identité. »
Nous sommes à la page 10 du dernier roman d’Andreï Makine. Qu’est-ce qui lui prend d’écrire des choses pareilles ? A quoi pense cet écrivain devenu académicien il y a trois ans ? Ignore-t-il que l’on n’a pas le droit d’écrire cela aujourd’hui en France ?
Et ça continue : « Les médias clamaient les bienfaits du vivre-ensemble et de la diversité mais lui retenait les scène réelles : à la sortie d’une supérette gisait cette femme et son bébé – égorgés. » (p. 11) Mais on finira par comprendre que ceci constitue le manuscrit que Vivien de Lynden, un jeune identitaire, a adressé à un écrivain qui ressemble beaucoup à Makine et qui est le narrateur de cette histoire. L’écrivain juge ce texte impubliable. Pourtant, à plusieurs reprises, les commentaires de cet écrivain rejoignent les jugements de l’identitaire. Vivien s’était adressé à lui parce qu’il est ami avec Gabriel Osmonde, un intellectuel qui était devenu son mentor. Or Gabriel Osmonde est le pseudonyme sous lequel sont publiés quatre livres écrits par un certain… Makine.
Dans ce labyrinthique jeu de miroirs, on se demande qui pense quoi. Et puis on finira par comprendre que la question n’est pas là. Elle porte plutôt sur des tragédies personnelles. Que deviennent les corps qu’emprisonne le ressentiment d’une haine de soi ? De quelle manière éprouver sa virilité lorsqu’on se découvre, comme Vivien de Lynden, fils d’un homme devenu homosexuel ? Comment les êtres humains se débattent-ils dans ce pays, le nôtre, où il n’y a pas de goulag mais des enfers où sont précipités ceux qui ne pensent pas correctement, qui ne disent pas les bonnes choses ou qui prononcent des mots tabou ?
Un Makine dans l’Oural venimeux de notre pensée unique
Quel héroïsme peuvent trouver des existences qui ne sont pas confrontées à la violence explicite du totalitarisme soviétique, mais à la perversion rampante de nos sociétés de consommation ? Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, craignez ceux qui détruisent les âmes, nous avertissait le Christ en Matthieu, 10, 28. Boulevard saint Marcel, une affiche des Gilets jaunes cite Soljénitsyne : « On asservit les peuples plus facilement avec la pornographie qu’avec des miradors ».
Tels sont les maux, les misères contre lesquels se débat l’humanité décrite dans le dernier Makine. En 2006, dans Cette France qu’on oublie d’aimer, il considérait déjà notre beau modèle social français comme une « machine à transformer l’homme en parasite social ».
Un peu plus loin, cette fois c’est le narrateur qui parle : « J’ai dit à Lynden : « Regardez-les ces jeunes Blancs. Ils vont penser correctement, consommer bio, se reproduire entre eux, approuver les bombardements démocratiques. » (p.65) Il récuse ensuite l’absurde racisme des identitaires : « En quoi les Noirs et les Arabes que vous haïssez seraient-ils responsables du crétinisme de ces enfants gâtés ? Sa réaction m’a émue. Il se retenait de pleurer. » (Id.)
Les quatre points cardinaux de ses romans.
Aujourd’hui, le lecteur de Makine se sentira sans doute un peu perdu. Ce fut du moins mon cas. Qu’est-ce qu’un bon Makine ? Quatre points cardinaux structurent la plupart de ses romans : steppes sibériennes ou forêts interminables, violence de l’histoire où la politique broie les personnes, héroïsme de ceux qui se débattent contre sa monstruosité, et pour finir, amour surgi au milieu de la violence. Ainsi, La femme qui attendait guette depuis trente ans son homme parti au front. Violence de la guerre, amour impossible, fidélité héroïque et absurde. Le tout dans ces forêts argentées par le givre au rivage de la Mer blanche. Dans L’Archipel d’une autre vie, aux confins orientaux de la Sibérie et de la Chine, là où l’interminable continent plonge enfin dans le Pacifique, on traque un évadé des goulags qui se révèle être de la trempe de Dersou Ouzala. Violence soviétique, héroïsme du fugitif, amour improbable et d’autant plus magnifique. Nature sublime et hostile.
Imaginez alors ce que pourrait être un Makine situé à Paris, loin des steppes russes, de la violence explicite du régime soviétique et de l’héroïsme qu’il suscite. Notre violence à nous est libérale, libertaire : plus insidieuse, plus venimeuse. C’est le poison de la pensée unique. La nature s’est retirée loin de nos centres-villes et nos corps n’ont plus la vigueur qu’ils se donnent pour l’affronter en Sibérie. Ils sont tantôt alourdis comme celui de Gaïa, la mère désespérée de Vivien, tantôt amaigris, chétifs et grêles comme ceux des Hussards (les amis « identitaires » de son fils) qui ressemblent à leurs ennemis, les bobos de Libé. Chez Lynden, une photo montre ces derniers et Makine la décrit juste avant de reproduire le commentaire qu’en donne l’identitaire mais qui pourrait être le sien :
« Un cliché ancien : la première équipe de Libération. Des filles d’une laideur revendiquée, accrochées à leur mégot, les jeunes hommes cheveux longs et sales, sourires fuyants, corps ingrats. Un mot griffonné en bas de la page : «Un acte charnel entre ces créatures ne peut se faire que dans le dégoût et la haine de soi.» Ce qui est d’ailleurs l’unique contenu de leur journalisme. » (p 116)
Les corps sont trop chétifs ou trop lourds. La violence idéologique, quant à elle, est psychologique. Vivien de Lynden croira rencontrer le grand amour. Mais Johanna se révèlera être une journaliste d’Arte infiltrée dans leur groupe afin de dénoncer un groupuscule néo-nazi. (p. 150) Pas de bastonnade. Pourtant l’issue n’en sera pas moins tragique.
Plus loin, le narrateur nous donne un portrait saisissant d’un bobo quadra aperçu dans sa voiture en partance pour les sports d’hiver :
« Des années passées à obtenir des tonnes de diplômes, une tension inhumaine au travail, la peur d’une obsolescence professionnelle programmée et, en compensation – cette voiture, pareille à un corbillard, et cette femme-ado à la voix glaçante : « Tu as encore oublié la doudoune de Léo... » (p. 212 à 216)
Ce pseudo-paradis où des hommes sans virilité se pacsent avec des femmes-ado sans seins qui veulent devenir la meilleure copine de leur enfant, on ne le croit supportable que parce qu’on le sait bâti sur des fondations infernales :
« A moins d’être d’un cynisme intégral, il sait que son existence, ce joli bagne prédisposant au suicide, est un immense privilège face aux milliards d’affamés. Au moment où ses enfants sont traînés, crochet aux fesses, vers les neiges immaculées des pistes, d’autres enfants, à quelques heures d’avions, sont démembrés par les bombes. Il sait que son séjour au ski est une façon de légitimer ce monde-là, cette synchronie de guerres et de fêtes, de famines et de populations d’obèses. Et plus désespérant encore, ces milliards de pauvres, une fois repêchés de la misère, se transforment en prédateurs, pressés de rejoindre la « civilisation ». »
Pas besoin des neiges de l’Oural, nous avons cette voix glaçante de la femme-ado. Pas besoin de brutalité concentrationnaire, nous avons l’enfermement d’une pensée unique qui brise les âmes ici afin de mieux démembrer les corps un peu plus loin.
L’air de rien, Makine, dans un livre qu’on trouvera dans toutes les librairies, dénonce des horreurs que nos contemporains s’étaient habitués à ne jamais regarder en face.
Ainsi, à la p. 168, Gaïa, la mère de Vivie,n revient de la niaiserie de ses engagements dans des ONG humanitaires : « En bombardant les cibles civiles, en Libye, écrit-elle, on a utilisé des obus à uranium, des milliers d’enfants tués avaient moins de dix ans. Un ex-analyste de la CIA reconnaît que les djihadistes avaient été entrainés et armés par les USA et que Kadhafi a été attaqué car il ne voulait plus vendre son pétrole en dollars ». Mais à mesure que Gaïa se rapproche de la vérité, « ses écrits commencent à se heurter à des refus, son nom se fait rare dans les journaux, se déplaçant vers des sites « alternatifs ». »
N’allons pas pour autant classer Makine dans la catégorie « réac »
Certes, il répète comme une évidence que Vivien a été brisé par la découverte de l’homosexualité tranquille de son père. Il n’a pas eu la chance de prolonger les traditions aventurières de sa famille : « il n’a pas eu cette chance. Un jour il a vu deux hommes dont son père s’embrasser sur la bouche. Et les rêves de circumnavigation se sont résumés aux escapades humanitaires de sa mère. » (p 218) Sur ce point, le voici délicieusement – dangereusement - incorrect. Néanmoins nos pauvres hussards agitent une colère dérisoire qui s’enracine dans la même faiblesse que celle que les bobos exalte dans un ressentiment suicidaire. « Si on vous remplace, c’est parce que vous vous êtes résignés à être remplaçables. Celui qui ne veut pas l’être se bat » dit Osmonde à Vivien à la p. 170. Les européens chétifs et dévirilisés contrastent avec les envahisseurs africains, aux corps puissants, qui séduisent nos femmes (p. 152) et les empalent dans les films pornos dont se repaît piteusement Vivien le boiteux.
Voilà pour les deux premiers axes du roman : la nature, la violence politique. Reste l’héroïsme et l’amour. Pour l’amour, disons que quelque chose adviendra entre le narrateur et Gaïa dans les derniers chapitres. En ce qui concerne l’héroïsme, il faut se tourner vers une autre particularité de ce roman : sa référence à la philosophie de Gabriel Osmonde. Car ici il ne s’agit plus de l’héroïsme de ceux qui veulent survivre, mais de celui qu’il faut pour tout abandonner.
La philosophie de Gabriel Osmonde.
Sur un plateau télé, Andreï Makine expliquait récemment que l’être humain finit par comprendre qu’il y a en nous un désir, une aspiration que notre existence sociale est incapable de combler. Nous naissons dans le corps que nous donnent nos parents, avec ses potentiels et ses fragilités – première naissance. Ensuite nous allons nous démener pour nous donner à nous-mêmes une existence sociale acceptable – deuxième naissance. La plupart des hommes se contentent de cela. Mais certains, peut-être plus particulièrement ceux qui ont excellé dans l’une voire dans les deux premières naissances, finissent par comprendre que tout cela n’est qu’une prison et qu’il faudra tout quitter, franchir les frontières (de là le titre du livre) afin de renaître à tout autre chose : c’est l’Alternaissance.
« Attendez ! j’y suis : la Première naissance, dit-il, assure notre survie biologique, la Deuxième, notre survie au sein de la société. Enfin la Troisième – l’Alternaissance – la survie au-delà de nos identités, biologiques et sociales (…) au-delà de notre disparition physique (…) ce qu’il appelle « le temps de la pérennité ». » (p. 265-266)
Savoir tout quitter. Tout perdre afin de se trouver. Ce qu’on souhaite de tout son cœur au bobo quadra que glaçait la voix de sa femme-ado. On pense à Into the wild, le film mythique de Sean Penn. C’est aussi le saut dans le vide que produit l’évasion du soldat dans L’archipel d’une autre vie. Du reste, Au-delà des frontières s’achèvera dans une petite communauté de « diggers » (ceux qui suivent cette philosophie) perdue dans les massifs caucasiens d’Abkhazie.
Cette éthique de l’évasion repose aussi sur une certaine ontologie de la temporalité déjà évoquée dans le titre d’un recueil de nouvelles : Le livre des brèves amours éternelles. L’oxymore n’est qu’apparent. Certains moments très simples sont assez vrais pour nous placer instantanément en harmonie avec le cosmos et son éternité. Une promenade pour aller chercher le courrier au bout d’une petite propriété, dans les Flandres belges, par une après-midi ensoleillée de printemps, et voici notre existence subrepticement plongée dans l’éternité – dernières pages de notre roman. Il y a des passages similaires dans L’immortalité de Kundera où certains gestes ne vieillissent pas.
Comment comprendre que notre existence nous demeure insuffisante ? Nous courrons si obstinément après des choses qui nous échappent que nous avons beaucoup de mal à découvrir qu’elles ne nous combleront jamais. Dans mon livre, La sagesse du désir (DMM, 2015) j’essayais d’expliquer combien il est difficile de renoncer à ce qu’on n’a pas obtenu. C’est là que réside le contresens nietzschéen sur la morale chrétienne : un François d’Assise, un Thomas d’Aquin ne renoncent pas par dépit à une grandeur dont ils étaient frustrés. Au contraire, ce sont les vainqueurs qui savent renoncer à ce qu’ils ont conquis. Le modèle du renoncement chrétien, c’est le Christ dont saint Paul nous dit qu’il ne retint pas jalousement la divinité qui l’égalait à son Père mais s’est abaissé jusqu’à nous, jusqu’à la croix.
Comment apercevoir notre médiocrité lorsqu’on n’a pas ce miroir du héros, du saint, du Christ ? Comparons un Russe avec un autre. Dans Stalker, Tarkovsky imaginait une « zone » dans laquelle chacun pourrait accomplir son désir le plus cher et par conséquent être confronté à sa cruelle vanité. Dans La peau de chagrin, Balzac attribuait à un chiffon de cuir le pouvoir surnaturel d’accomplir la même révélation que « pouvoir brûle, vouloir détruit » : nous brûlons de désir jusqu’au jour où nous en découvrons la vanité au moment où il se réalise.
Makine-Osmonde imagine une machine qui permet de vivre ses désirs : une sorte de casque à réalité augmentée nommé « métapraxie ». Aux pp. 143-145, Vivien raconte : « Il me proposa d’essayer « la machine à rendre heureux » - la métapraxie (…) la tête coiffée d’un casque aux multiples capteurs (…) Les premières images mentales précèdent l’immersion (…) Une coulée de cheveux blonds sur les épaules d’une jeune fille, son sourire naissant. Voir son corps se dénuder ne me surprend pas (…) Sa bouche, dans un murmure expiré, épelle mon prénom (…) Et c’est à ce moment que plusieurs hommes s’introduisent dans la pièce. Ce sont de « Gros noirs », formule ma pensée et je ne comprends pas pourquoi je dois leur reconnaître leur inexplicable priorité. » Le rêve érotique se transforme en cauchemar, en aveu. Le pauvre Vivien assiste finalement à son déclassement. Il voit comme en un film la vérité qu’il ne s’avouait pas. La scène finit dans un éclair de lucidité : « Osmonde m’aide à ôter le casque, à quitter la pièce (…) avec le recul je comprends que le côté délirant de mon rêve métapratique n’avait rien d’irréel. Les mêmes faits se sont produits à Cologne. » Vivien nomme cet épisode « Dans la peau de mon double ». Sa mère vivra une expérience similaire avec la même machine, aux pp. 182-186. En vivant nos désirs avec une intensité que nous n’espérions pas, nous saisissons leur vanité et du même coup la fausseté de notre existence.
Ce roman décrit à plusieurs reprises des actes sexuels plutôt crus ainsi que l’addiction pornographique de Vivien. Makine admire Houellebecq. Jusqu’à présent cela ne se voyait pas. Néanmoins, ces descriptions dénoncent à chaque fois le conformisme social et le dégoût qui se cachent derrière des fantasmes qu’on croyait simples et personnels. En somme, chose nouvelle pour moi, Makine est aussi le narrateur de notre médiocrité sociale.
Un roman sur le tragique de notre médiocrité occidentale
Gaïa avait fini par revenir de ses idéaux humanitaires, tout comme Laura Baroncelli, l’anti héroïne du « premier roman » de Gabriel Osmonde : Le voyage d’une femme qui n’avait plus peur de vieillir (Albin Michel, 2001). Gaïa et Laura, sont toutes les deux un peu rondes, entre deux âges, trahies par leur mari, abandonnées au ravin de l’existence qu’elles se résignent à quitter, songeant sérieusement au suicide. Toutes deux attendent une rencontre qui les sauverait de l’exténuation de leur vie dans le lent étouffement de la vieillesse, à l’image de Thérèse Desqueyroux exilée à Paris, dans La fin de la nuit. En somme, ces deux romans, l’un de Makine, l’autre de Gabriel Osmonde, se ressemblent beaucoup. Pourquoi le Voyage d’une femme qui n’avait plus peur de vieillir a-t-il été écrit sous le pseudonyme de Gabriel Osmonde ? Parce qu’il représentait déjà en 2001 – et donc trop tôt ? une sorte d’anti Makine : si loin de la grandeur des héros soviétiques de ces grands romans. Peut-être. Le contraste entre ces deux livres d’une part et la grandeur de La musique d’une vie, de La vie d’un homme inconnu, de L’Archipel d’une autre vie, d’autre part, me fait penser à celui qui oppose certains romans de Montherlant à ses pièces de théâtre. Un Assassin est mon maître, Le Chaos et la nuit, et surtout Les célibataires dépeignent une humanité abîmée et médiocre tandis que les pièces magnifiques que sont Le cardinal d’Espagne, La reine morte, Port-royal, Le Maître de Santiago nous font admirer une humanité supérieure, grandiose, exaltante et tragique.
Dans sa Poétique, Aristote opposait deux genres. Le tragique nous fait admirer des héros tandis que la comédie nous fait rire de nos travers. Ce qu’il y a de post-moderne dans certains romans de Montherlant, comme dans Osmonde et dans ce déconcertant Makine, c’est le fait de décrire le tragique de la médiocrité à laquelle les personnages ne se résignent pas. C’est aussi ce qui oppose Makine à la plupart des écrivains contemporains qui célèbrent au contraire, sans retenue et avec un narcissisme complaisant la médiocrité dans laquelle notre société de consommation a plongé l’humanité occidentale.
Et le ciel ?
Makine déplore notre matérialisme occidental saupoudré d’humanitarisme libertaire. En le lisant, on se trouve plein de compassion pour les personnes qui refusent de s’en contenter. Que leur reste-t-il alors ? Qu’espérer ? Ce Russe paradoxal dont les livres sont traduits en quatorze langues mais pas dans la sienne semble totalement étranger à la mystique orthodoxe. Il n’en parle presque jamais.
Pourtant l’alternaissance pourrait bien s’apparenter à une sorte de mort joyeuse où s’éprouverait le vertige d’une rencontre avec la vérité du monde. Dans les dernières pages de Au-delà des frontières, blottis sur les alpages caucasiens d’Abkhazie, Gaïa et son ami le narrateur découvrent un ancien manuscrit qui parle d’un dialogue entre deux jumeaux non encore nés : l’un annonce à l’autre leur vie future où ils pourront marcher, respirer etc. « L’autre, incrédule : comment peut-on voir, respirer, marcher ? Et de quelle mère parles-tu ? » (p. 266)
Nous ignorons tout de cette autre vie au bout du voyage : « Nos mots humains ne sont pas faits pour décrire cet alliage de lumière et de silence. » (p. 267) Qu’est-ce sinon une description apophantique ?
Le voyage d’une femme qui n’avait plus peur de vieillir s’achève aussi sur un « miraculeux départ » auquel elle était « mystérieusement prédestinée », vers lequel « elle était en route depuis sa jeunesse, depuis son enfance » (p. 276), un voyage vers « les neiges infinies » (p. 278, je souligne). Laura, petite sœur de Gaïa se retrouve en se perdant dans « le vide blanc, absolu » dans cette contrée perdue à l’extrême nord : « Personne n’y est jamais allé. Personne n’en est jamais venu. Là-bas il n’y a rien, là-bas même la neige n’a plus sa couleur ».
Mais dans cette vie on n’est pas seul. Laura avait découvert, une nuit, chez elle, un bel inconnu mystérieux, silencieux, qui hantait sa maison et l’a sauvée une première fois de la mort. Elle finit par le trouver, le perdre, le sauver d’une bagarre. On ne sait rien de lui. C’est un étranger. Mais c’est comme s’il avait toujours été là, fascinant, ami amant évanescent. Tout comme le visiteur de Théorème de Pasolini. Celui à qui elle était destinée. Depuis toujours.
PL.
Pierre Labrousse est agrégé de philosophie, auteur de La sagesse du désir, Paris, Dominique Martin Morin, 2015.