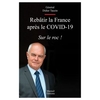Nos coups de coeur
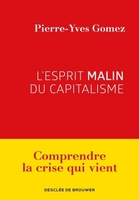
La remise en cause du système économique actuel vise notamment ce qu’on appelle la financiarisation, qui polarise l’attention de beaucoup. C’est ce que fait Pierre-Yves Gomez, dans un livre très critique paru récemment, L’esprit malin du capitalisme. Cet auteur chrétien bien connu actif ne recourt toutefois pas explicitement ici à des références chrétiennes
Il décèle un changement majeur dans la vie économique, qui pour lui prend sa source dans la finance. L’idée est que les ressources financières disponibles sur les marchés se sont massivement développées, et deviennent la source principale de financement. Mais pour y avoir accès, les entreprises sont soumises à une pression incessante : faire des promesses, basées sur l’innovation permanente et le dépassement de l’existant, par définition non connus à l’avance ; en un mot, la rupture permanente. Le passé est dévalué au profit du seul avenir, dont on attend l’effacement des ‘dettes’, c’est-à-dire des promesses faites. Une autre idée de l’auteur est que cette évolution - qui n’est pour lui pas le fruit d’un complot et d’une cause unique-, est seule déterminante ; la sphère des idées et du politique (le postmodernisme, la théorie du marché efficient, 1968 etc.) est selon lui conditionnée par elle et non l’inverse, selon un schéma de type marxiste. Une autre idée enfin est qu’il n’y a pas aujourd’hui d’économie de marché, mais une économie de marchands, qui fixent la valeur des choses, donc les prix. Cela oriente à la fois le financement et la production. Les gens croient que marché et technocratie s’opposent ; mais en réalité, dit-il, c’est une nouvelle technocratie qui a remplacé le Plan[1]. Et cette technocratie spéculative est devenue invisible. Mais suivant la logique ci-dessus décrite, elle structure toute la société.
Un tel système refuse la question du sens, car pour lui, il n’y a pas de sens à trouver. D’où l’hostilité de ce système aux communautés et usages traditionnels, qui sont en concurrence avec lui pour la détermination des valeurs. D’autant que cela inculque le sens de ce que l’on doit à ceux qui nous précèdent et à la communauté, alors que le système actuel ne valorise que ‘l’Avenir’. Le doute est son pire ennemi, car le système demande une croyance inébranlable dans les promesses de ‘l’Avenir’, l’idéologie ayant pour fonction d’éteindre ces doutes. Une de ses conséquences dans le domaine personnel est ce culte de l’adaptation permanente, de l’employabilité, qui réduit la personne à une évaluation : la dynamique de la spéculation se retrouve alors au niveau individuel. D’où le dilemme qui enferme la personne : stressée par la compétition, mais sans trouver du sens dans ce qu’elle fait, elle n’a de ressource qu’à se tendre vers ce fameux ‘Avenir’ évanescent.
Que faire alors ? L’auteur est sceptique sur la plupart des alternatives concevables : les révolutionnaires, car l’imaginaire correspondant a été récupéré par le système ; les conservatrices, car elles sont selon lui non pertinentes ; et même les écologistes. En effet, dit-il, la critique écologiste notamment mine l’humanisme lui-même, qui est pourtant la seule base de résistance au système, car l’homme est désormais reconnu coupable de tout ; et elle conduit à la recherche de solutions techniques, ce qui ressort de la compétence du système, et donc paradoxalement renvoie à sa logique. L’auteur prévoit des crises, mais, dit-il, le capitalisme spéculatif repartira de l’avant, tant qu’il trouvera des relais de croyance et d’investissement. Même le jeu mimétique à la René Girard que suscite le culte de la consommation ne débouchera pas sur l’explosion : « tant qu’il espère en l’Avenir, la violence collective que le désir mimétique pourrait engendrer est bloquée » (p. 114). Ce système est donc pour l’instant notre horizon indépassable. Il nous reste seulement à protester de la vie vécue, comme dans le cri populaire : « ce n’est pas une vie ! », et manifester « la différence irréductible entre le monde prescrit et le monde vécu » (p. 281).
Que dire de cette analyse, assez désespérante dans ses conclusions ? Elle décirt bien sûr un aspect important de la réalité, mais se laisse trop tentée par la généralisation d’une seul principe explicatif. Notons d’abord l’erreur conceptuelle de faire de l’infrastructure économique la cause de la superstructure intellectuelle et culturelle, à la façon marxiste. Il est pourtant évident que, contrairement à ce que dit l’auteur, le relativisme moderne et le postmodernisme, qui datent au plus tard des années 60, ne résultent pas de l’évolution décrite dans la sphère économique et financière, qui ne s’est déployée que dans les années 80. Or ce n’est pas qu’une question théorique, car il est essentiel de savoir où se situent les déterminants de fond. Comme je l’ai montré ailleurs[2], le fait de base dans nos sociétés est ce paradigme relativiste, qui a atteint sa forme la plus radicale à partir des années 60 et 70, et s’est encore développé depuis, qu’on appelle le postmodernisme. Tant qu’il dominera nos cultures, il sera difficile d’espérer un changement en profondeur. Le cri désespéré « ce n’est pas une vie ! » ne peut prendre de sens, et déboucher sur une sortie, que dans une remise en cause de cet a priori relativiste, qui est le meilleur allié d’une organisation économique matérialiste, basée sur la seule compétition.
En outre, il y a une superstructure idéologique autonome dans le champ financier, avec notamment la théorie des marchés efficients et le culte idolâtrique de la valeur actionnariale. Ils ne sont pas la résultante de l’évolution des marchés, contrairement à ce que dit l’auteur, mais une de ses causes, notamment au travers de la libéralisation des années 80, qui est d’abord idéologique et politique. Enfin, il est simpliste de résumer le dilemme sur l’avenir entre d’un côté ce système avec son jeu spéculatif de promesses sans cesse reportées, mais qui le font marcher, et de l’autre des écologistes désespérant de l’homme, ou des conservateurs sans horizon. Le jeu collectif est autrement plus ouvert.
En revanche, il est juste de souligner cette propension du système actuel à multiplier les promesses, dont l’effet est reporté dans l’avenir, plutôt qu’à se réformer, ou à explorer d’autres ressources humaines et culturelles. D’où la prolifération de l’endettement, qui atteint des proportions sans précédent dans l’histoire et éminemment dangereuses. Mais plus qu’un effet de la financiarisation, cela résulte de l’incapacité à se réformer. On le voit avec les dettes publiques, résultat direct de l’absence de consensus politique sur des choix responsables[3]. La question principale de la finance, comme je l’ai montré par ailleurs[4] est celle des priorités morales, politiques, sociales et culturelles, et des règles qui en découlent : de la société d’une part, des détenteurs de capitaux et des gestionnaires de fortune de l’autre. Priorités qui se traduisent à la fois dans les lois et dans leur comportement.
Lecture néanmoins recommandée, si on fait la part du feu. Pierre de Lauzun
[1] Le capitalisme n’est, dit-il, pas la propriété des moyens de production, mais une technocratie qui dit comment établir la valeur des choses, que ce soit le capital ou le travail (p. 189).
[2] Voir Pierre de Lauzun, Pour un grand retournement, Paris, Éditions du Bien commun, 2019
[3] Et non principalement de la crise financière de 2008, sur laquelle l’analyse de l’auteur est déficiente pour des raisons qu’on ne peut développer ici (p. 122).
[4] Finance un regard chrétien, Embrasure 2013. Ou La finance peut-elle être au service de l’homme ? DDB 2015.