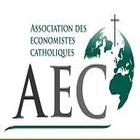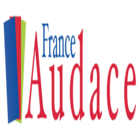LA POSITION DE JEAN-PAUL II sur la famille est connue : le Saint-Père insiste d'abord sur le fait qu'elle est fondée par le mariage d'un homme et d'une femme, et qu'elle est la seule institution investie du pouvoir exclusif de transmettre la vie.
Son enseignement a été, pendant un certain temps, concurrencé par les mouvances féministe et libérale, qui ont tenté d'introduire l'expression de " familles ", au sens de tout groupe de personnes adultes vivant ensembles. Dans la définition libérale, les couples homosexuels sont inclus.
L'enseignement de Jean-Paul II n'inclut pas ces types d'associations de personnes dans la définition de la famille et leur décline le bénéfice du statut familial . Contrant les efforts des libéraux et de la gauche, qui visent à " légaliser " ces modes de vie commune en les regroupant sous le terme de " familles ", le pape insiste en conséquence sur le fait que la famille préexiste à la société et à l'État, parce qu'elle est plus ancienne.
La famille n'est pas, contrairement à " l'institution historique " que les disciples de Karl Marx et Friedrich Engels voulaient en faire, une création artificielle résultant de conditions socio-économiques spécifiques. Elle ne constitue pas une institution que l'État ou les organisations internationales peuvent modifier librement. Institution naturelle fondée sur l'existence même de l'être humain, elle est aussi une réponse adaptée aux besoins de l'homme (besoins de parents, d'enfants) comme aux besoins de la société. Elle s'enracine, non pas seulement dans un consensus social, mais également dans la volonté de Dieu et dans la sagesse humaine.
La Charte des droits de la famille dispose que la famille, bien plus qu'une simple unité juridique, sociologique ou économique, constitue une communauté d'amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et transmettre des valeurs culturelles éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société. Tout ce qui représente un danger pour la famille constitue en réalité un danger pour l'être humain .
Pour toutes ces raisons, la société, l'État, sont obligés d'accepter, de soutenir et de protéger la famille. Davantage encore : la société et, de façon particulière, l'État et les organisations internationales, doivent protéger la famille, par des mesures politiques, économiques, sociales et juridiques, qui ont pour but de renforcer l'unité et la stabilité de la famille, afin qu'elle puisse exercer sa fonction spécifique .
Droits de l'homme, droits de la famille
et... obligations de l'État
Dans la doctrine sociale de l'Église catholique, la personne humaine occupe une place centrale en tant que " fils de Dieu ". Comme telle, toute personne est dotée de droits innés, inaliénables et inviolables. Tous ces droits peuvent être résumés dans les droits à la vie, à la liberté et au bonheur. En tant que société naturelle, issue d'un homme et d'une femme, préexistant à l'État et à toute autre communauté, la famille possède des droits inhérents qui sont, eux aussi, inaliénables . En fait, tous les droits de la personne humaine sont les droits de la famille. Parce que celle-ci est une communauté de personnes, son épanouissement dépend, de manière significative, de la juste application des droits des personnes qui la composent .
Certains droits appartiennent immédiatement à la famille en tant que telle, comme celui des époux à fonder une famille, celui des parents à réguler les naissances (à l'exclusion du recours à la contraception, à la stérilisation ou à l'avortement), à éduquer leurs enfants en accord avec leurs convictions morales et religieuses, droit de vivre librement sa propre vie religieuse, de s'associer à d'autres familles et institutions, à vivre dans des conditions économiques garantissant un niveau de vie conforme à leur dignité et à leur plein développement, et le droit à un logement décent . Certains droits touchent immédiatement la famille : c'est le cas du droit de propriété ou du droit au travail .
Il faut signaler que le concept de " Droits de l'homme " occupe une place toute particulière dans la doctrine sociale de l'Église catholique, et plus particulièrement encore dans l'enseignement de Jean-Paul II. L'obligation de les respecter et de s'y conformer repose sur tout le monde et sur toutes les institutions sociales, au nombre desquelles figure l'État. Ils ont une prééminence absolue sur toute loi édictée par le peuple. Et il importe peu que ces lois soient le fait d'un dictateur ou qu'elles résultent d'un processus démocratique. Une véritable justice ne peut être garantie qu'à la condition que les lois décidées par le peuple soient en accord avec les Droits de l'homme. Il faut d'ailleurs signaler que, dans la liste des Droits de l'homme, figure aussi celui de défendre ceux-ci par des moyens justes mais efficaces.
Chaque fois que se pose la question des droits, le problème de la légitimité ressurgit. On devrait toujours garder présent à l'esprit qu'il arrive parfois que les droits de certaines personnes ne puissent être protégés, ou mis en œuvre, qu'au prix d'autres droits. La doctrine sociale de l'Église insiste sur le fait que cette contradiction doit trouver sa solution dans le respect des règles de la solidarité et du bien commun.
Solidarité et subsidiarité :
fondements d'une politique de la famille menée par l'État
La doctrine sociale de l'Église utilise deux critères (ou règles), à travers lesquels elle juge tous les systèmes sociaux et politiques, ainsi que les institutions : ces critères sont ceux de la solidarité et de la subsidiarité.
La solidarité signifie que personne ne puisse être abandonné face à des problèmes ou des responsabilités qui dépassent ses capacités. Cette règle ne laisse donc aucune place pour un " darwinisme social " ou toute autre forme d'égoïsme. C'est dans ce principe que s'enracinent les fortes critiques formulées dans l'enseignement de Jean-Paul II à l'encontre d'un capitalisme libéral " sauvage ".
La subsidiarité signifie qu'il n'est pas d'institution ou d'État qui soit autorisé à intervenir dans des matières qui peuvent être prises en charge par la famille ou qui peuvent trouver une réponse appropriée dans le cadre de la famille. Plus précisément, la règle de subsidiarité signifie également qu'un gouvernement régional ne doit pas intervenir dans des matières qui peuvent être prises en charge par les communes, et que le gouvernement central ne doit pas s'immiscer dans les problèmes qui sont à la portée des autorités régionales, ou encore qu'il existe des problèmes que seuls les gouvernements nationaux peuvent résoudre, et dans lesquels la communauté internationale ou les organisations internationales n'ont pas à intervenir.
La doctrine sociale de l'Église dispose que tout le monde doit défendre ses droits, et qu'il y a une légitimité du peuple à s'organiser en défense de ceux-ci ou de ses intérêts. Toutefois, dans le même temps, la doctrine insiste sur le fait que seul le bien commun doit constituer le but principal de toute activité. Aucun égoïsme national ou de " classe " ou de " race " n'est valable. Même en cas de situations conflictuelles, les parties opposées ne doivent pas chercher à se détruite entre elles, mais s'efforcer de respecter leurs droits et intérêts mutuels.
Les politiques de la famille s'adressent-elles à la famille
ou aux besoins de la famille ?
Il serait possible, bien sûr, d'analyser toute politique sociale en adoptant le même critère et en l'appliquant aux conséquences induites par cette politique sur la vie de la famille. Mais lorsqu'on évoque la " politique de la famille ", c'est généralement à des politiques dirigées vers la famille et ses besoins que l'on pense. Or, et il faut insister sur ce point, une politique de la famille ne peut être telle que si elle n'est pas reliée à une quelconque infortune humaine ; une politique de la famille devrait s'intéresser à la famille – et non spécifiquement à la famille pauvre (ces dernières devraient relever d'organismes caritatifs ou de programmes sociaux) ; ce ne doit pas être non plus une politique en direction des familles monoparentales : celles-ci devraient bénéficier de l'aide des programmes de sécurité sociale ou d'assistance publique.
Voici plusieurs des raisons qui justifient ces exclusions et ces distinctions :
1. la famille n'est pas une infortune, et ne doit pas être traitée comme telle ;
2. les programmes qui prennent en compte des seuils de revenus sont susceptibles d'engendrer des " trappes à pauvreté " ;
3. lorsque deux infortunes se conjuguent (par exemple, de faibles revenus et un parent isolé avec un enfant à charge), la " trappe à pauvreté " devient très difficile à surmonter et devient dans le même temps socialement et moralement perturbante. Le programme américain AFDC, notoire pour ses effets, en est peut être la meilleure illustration ;
4. les politiques subordonnées à des seuils de revenus perdent rapidement le soutien de la société.
Les problèmes sociaux doivent être traitées avec un maximum d'attention, et les programmes dont ils font l'objet doivent être administrés à un niveau aussi décentralisé que possible (voire même, éventuellement, au niveau du voisinage ou de la communauté), selon un principe reposant sur le cas par cas.
D'un autre côté, il importe d'offrir aux familles une aide, parce qu'elles sont essentielles à la société, à la nation, à l'État et à l'humanité tout entière. Elles jouent un rôle de premier plan dans la vie sociale, économique et culturelle. Elles sont l'institution la moins coûteuse qui prend en charge à la fois les jeunes et les vieux, les malades et les chômeurs. Elles constituent également une institution très importante en matière d'éducation. C'est l'intérêt de la société de procurer à la famille une assistance effective.
J. K.