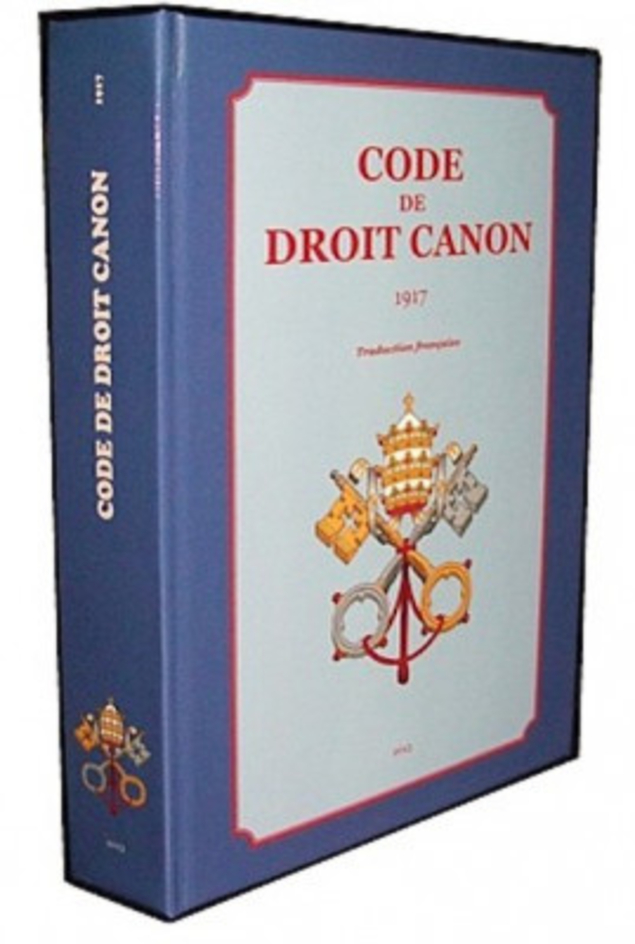
Source [L'Homme Nouveau] Cyrille Dounot est professeur d’histoire du droit (Clermont-Ferrand) et avocat ecclésiastique preès l’officialité de Lyon. Il livre ici une remarquable analyse de l'évolution du droit canonique à l'occasion de différentes épidémies qui se sont produites dans l'Histoire. Une étude très éclairante pour notre situation.
L’épidémie actuelle contraint les ordres juridiques nationaux à de substantielles modifications, notamment dans notre pays, par la suspension de plusieurs libertés publiques et l’instauration d’un « état d’urgence sanitaire » (interdiction des célébrations religieuses, prix maximums fixés par décret, possibilités de réquisitions, confinement obligatoire, etc.). L’ordre juridique canonique est aussi directement impliqué, dans ses dimensions locale (prescriptions diocésaines) et universelle (lois ecclésiastiques). Pour preuve, les trois récents décrets de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements qui aménagent certaines règles liturgiques face à « l’évolution rapide de la pandémie de Covid-19 ». Ces décrets, rendus suite aux diverses sollicitations émanant d’évêques du monde entier, rappellent quelques éléments doctrinaux comme l’impossibilité de transférer la fête de Pâques, la nécessité de célébrer la messe même en l’absence de fidèles ou encore l’importance de la prière. En outre, ils apportent quelques dérogations aux règles liturgiques en vigueur « dans les pays touchés par la maladie » et pour la seule année 2020.
La situation actuelle
L’insistance est mise sur l’information des fidèles quant à l’heure des célébrations, afin qu’ils puissent s’y unir par la prière, et sur l’utilité des « moyens de communication télématiques en direct, et non enregistrés ». Le décret du 25 mars ordonne la célébration « des rites de la Semaine sainte sans la présence du peuple et dans un endroit approprié, en évitant la concélébration [le décret du 19 mars donnait à tous les prêtres la faculté de célébrer la messe de la Cène du Seigneur] et en omettant l’échange de paix ». Plus précisément, certains rites spécifiques seront omis, tels le lavement des pieds ou la procession du Saint-Sacrement du Jeudi saint, le feu pascal, la procession et les éléments de la liturgie baptismale du Samedi saint, restant sauf « le renouvellement des promesses baptismales ». D’autres rites sont restreints au seul célébrant, comme l’adoration de la Croix par le baiser du Vendredi saint. Enfin, d’autres sont modifiés, comme la Prière universelle qui se voit augmentée d’une intention « Pour ceux qui souffrent en ce temps d’épidémie » (décret du 30 mars 2020).
Ce droit canonique de l’urgence, adaptant les règles liturgiques aux nécessités, n’est pas sans rappeler l’existence d’un droit propre aux temps d’épidémie, lors de pestes en particulier, dont s’approchent certaines dispositions étatiques actuelles. Donnons un coup d’œil rapide sur les épidémies de peste qui ont eu des conséquences juridiques pour l’Église.
La Grande Peste
La Grande Peste de 1348, qui fera mourir au moins un tiers des Français, a des conséquences immédiates sur les institutions religieuses. Elle conduit Clément VI à instituer une messe spécifique, pro evitanda mortalitate, indulgenciée et accompagnée d’une pratique de dévotion propre à éviter la mort subite (les assistants à cette messe portent un cierge allumé durant la célébration). Il est bien sûr primordial d’implorer Dieu en temps de malheur et, déjà en 1335, le concile de Lund avait fait obligation aux prêtres, « aussitôt que Dieu frappe le pays par la peste, la famine, la guerre, les tempêtes ou la sécheresse, à cause de nos péchés, d’exhorter tout le peuple à la pénitence et aux ardentes prières, sans attendre les mandements des évêques » (can. 12).
Clément VI décide d’un ensemble de mesures d’urgence pour ce temps d’épidémie. D’abord, il fait ouvrir un nouveau cimetière, construire des logements individuels isolés pour les pestiférés et établir un rapport quotidien sur le nombre des morts. Ensuite, il aide les fidèles « dans cette terrible épreuve et, par un décret, il rappelle à tous les prêtres, religieux et religieuses que leur devoir est de visiter, secourir et soigner les malades ainsi que d’administrer les sacrements aux mourants. Puis il apaise les consciences en accordant l’absolution générale à tous les fidèles qui meurent de peste dans le repentir de leurs fautes, et une indulgence plénière à tous ceux qui, se repentant avec contrition, se dévouent pour soigner les malades ou ensevelir les morts » (1). Enfin, il institue des distributions quotidiennes de vivres, de vêtements et de médicaments, payant à ses frais des médecins pour soigner les pauvres d’Avignon, et sollicite le roi de France pour qu’il ne lève pas de taxes dans certains diocèses dévastés.
Le pontife avignonnais est amené à prendre deux autres décisions, l’une en protégeant les Juifs des attaques dont ils étaient victimes en excommuniant ceux qui les molesteraient, l’autre en condamnant le mouvement révolutionnaire des Flagellants, qui souhaitaient son approbation (2). La peste finie, il décide d’organiser un jubilé pour 1350 pour remercier Dieu de la guérison et rasséréner les esprits.
Une des conséquences inattendues de cette peste est d’avoir causé une pénurie de vin en Islande, faute de débarquement de bateaux norvégiens, ce qui entraîna une interruption de la célébration des messes dans la plupart des églises du pays. Sur le continent, certains ecclésiastiques peu soucieux du bien des fidèles avaient profité de l’épidémie pour augmenter indûment les taxes. Il s’agissait notamment des vicaires et des officiaux qui avaient profité de l’absence d’évêques (morts ou exilés) pour commettre ces exactions. Le concile de Tarragone de 1357 leur impose de revenir au montant des taxes fixé précédemment, punissant toute majoration (can. 12).
Ainsi, dans la décennie suivant le déclenchement de l’épidémie, quelques règles juridiques sont venues régir ces temps particulièrement troubles. La mémoire de la peste reste vive dans les esprits du XVe siècle, à tel point que le concile de Constance, dans le décret conciliariste Frequens de 1417, ne prévoit que deux exceptions à la fixation du lieu du prochain concile : la peste ou la guerre.
Les commentateurs de ces textes se font parfois médecins en prescrivant les bonnes manières d’exercer le ministère auprès des contagieux : se tenir à distance lors de la confession, ne pas visiter les malades le ventre vide, appliquer sur ses narines de la thériaque ou maintenir sur le nez une bandelette imbibée de vinaigre, ne pas avaler sa salive, manger des citrons, ou du moins des zestes, etc. D’autres étudient la question à fond, tels le Bolonais Girolamo Previdelli et son Tractatus legalis de peste publié en 1524, le Pavesan Gianfrancesco Riva di San Nazzaro (1480-1535), avec son Tractatus de peste imprimé en 1598, ou le théologien liégeois Jean Chapeauville (1551-1617) avec son Traité de la nécessité et de la manière d’administrer les sacrements en temps de peste, paru en latin en 1586, qui dévoile la matière en 212 questions. C’est que le malheur de la peste avait resurgi sur le devant de la scène.
La peste milanaise de 1576
Quand l’épidémie frappe la cité de saint Ambroise en 1576, Charles Borromée en est l’évêque depuis treize ans. Neveu du pape Pie IV, ce saint évêque applique au mieux la Contre-Réforme engagée par le concile de Trente. Dévoué corps et âme à son peuple, il va œuvrer pour juguler ce que la postérité appellera la « peste de saint Charles ». D’abord par les moyens surnaturels, en organisant des prières publiques – dont une procession à la tête de laquelle, pieds nus, il porte les reliques du saint Clou –, en distribuant la communion, en conférant personnellement la confirmation aux malades, en organisant des confessions et des services funèbres solennels. Ensuite par la consolation, en exhortant les Milanais par la parole et par la plume. Enfin, par des mesures administratives concernant les devoirs des clercs de son diocèse. La question était de savoir si les clercs étaient tenus d’administrer les sacrements aux personnes infectées. Saint Charles Borromée répond en deux temps.
D’abord, les curés doivent rester en place et ne pas fuir le danger. Ils sont tenus à résidence, et il est loisible d’agir en justice contre ceux qui ne respectent pas cette règle, conformément aux canons réformateurs du concile de Trente (sess. 23, can. 1). En ce cas, il convient de procéder d’abord par censures, ensuite par séquestres, enfin par privation de l’office. Un décret romain du 23 décembre 1576 vient rappeler cette obligation des curés à résider dans leur cure. Grégoire XIII déclare que cette obligation vaut à plus forte raison pour les évêques, qui peuvent cependant pourvoir au nécessaire depuis un lieu sûr. La Sacrée Congrégation des Évêques juge qu’un évêque pourvu d’un coadjuteur est aussi tenu à résidence (24 mars 1597), même en temps d’épidémie (7 septembre 1619).
Ensuite, les clercs doivent administrer les sacrements de nécessité que sont le baptême et la pénitence en temps de peste, même au péril de leur vie. Charles Borromée ayant informé le pape de ses dispositions, ce dernier réunit un consistoire le 10 septembre 1576. Il répond au saint archevêque pour louer sa conduite, porter la question (dubius) à la connaissance de la Congrégation et décréter que les curés sont tenus d’administrer les deux sacrements. C’était concrétiser en termes de droit ce que les théologiens affirmaient depuis longtemps, à l’instar de saint Thomas d’Aquin pour qui « la charité n’exige pas nécessairement qu’on expose son corps pour le salut du prochain, hormis le cas où l’on est tenu de pourvoir à son salut » (IIa IIae, q. 26, a. 5, ad 3m). Le 12 octobre, le pape approuve le décret de la Congrégation, donnant la faculté de réaliser cette obligation par un autre clerc idoine. La raison principale vise à permettre au curé de continuer à entendre les confessions des personnes saines, qui sans cela redouteraient de se confesser à un prêtre allant vers les pestiférés, par peur d’une contagion. La raison secondaire est de laisser le curé à ses exhortations, prédications et consolations de ses ouailles.
Il en va de même pour l’obligation d’administrer l’extrême-onction, qui repose sur le curé soit personnellement soit par autrui. Pour le canoniste Ferraris, le prêtre pèche mortellement s’il refuse d’administrer les derniers sacrements à un pestiféré, « même avec le risque d’être contaminé, si l’infirme n’a pas d’autre moyen de recevoir le Sacrement » (3).
Les clercs doivent de même porter des habits resserrés, abandonner le pluvial, et n’user que du seul surplis et de l’étole. Ils doivent employer, pour la célébration de la messe, des ornements et des calices qui leur sont propres, et si possible célébrer sur des autels distincts dans des chapelles séparées. Si cela est impossible, il convient que chacun use de nappes d’autel distinctes.
Enfin, saint Charles introduit quelques modifications, dites précautions, dans certains rites liturgiques. Pour le baptême, il convient de l’administrer immédiatement au nouveau-né par infusion (4), et non par immersion, en omettant les autres rites, surtout si la mère est affectée ou susceptible de l’être. En revanche, dès que la suspicion cesse, il faut revenir à l’église accomplir ce qui a été omis. Pour la confession, elle doit se tenir en respectant une certaine distance entre le pénitent et le confesseur, et peut avoir lieu dans des lieux inaccoutumés : aux portes, fenêtres, etc. en évitant la chambre à coucher du pénitent infesté.
En 1579, saint Charles Borromée réunit son cinquième concile provincial et y intègre toutes les précautions et réglementations édictées lors de la terrible peste de 1576. De la sorte, la longue seconde partie de ces constitutions (plus de trente pages) devient un exemple de conduite épiscopale à tenir en cas d’épidémie. À titre d’exemple, s’il ordonne des processions publiques quotidiennes, il institue une « distanciation sociale », c’est-à-dire « que les hommes ne soient pas massés ni en foule et comprimés les uns les autres, mais en ordre distinct, et séparés d’un intervalle, pour ne pas donner lieu à la contagion ». Pour la célébration des messes, qu’il encourage, il demande à son clergé de ne pas célébrer à la même heure, ni dans les mêmes églises (surtout si elles sont étroites), afin d’éviter les rassemblements. Les enseignements de la doctrine chrétienne sont maintenus, mais dans un lieu aéré et ouvert, comme un cimetière, une place publique, un carrefour.
Les pouvoirs publics sont invités à prendre les mesures nécessaires, mais non au détriment des libertés de l’Église et des droits des évêques, « qui ne sont pas moins chargés de la santé et du salut du peuple ». Ainsi, les autorités peuvent décréter des confinements, mais seulement pour un temps, et si possibles limités aux femmes avec enfants, voire à un quartier seulement, et sans toucher aux divins offices de l’Avent, du Carême, des fêtes de Pâques ou des autres solennités du Seigneur, car il ne faut pas moins craindre « la contagion de la peste des âmes que celle des corps ».
Au XVIIe siècle, d’autres hypothèses sont envisagées dans des textes issus des congrégations romaines. En 1656, Alexandre VII enjoint à l’archevêque de Naples de publier un édit pénal interdisant à tout clerc (séculier ou régulier) d’oser entrer dans ladite ville en cas de suspicion de peste, sans un laisser-passer écrit concédé par l’ordinaire. Le même pape enjoint au nonce de punir sévèrement cinq chanoines du Latran désobéissants, tout comme l’abbé qui leur a donné l’hospitalité.
Les ordres hospitaliers reçoivent des missions précises, notamment les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ils obtiennent des facultés spéciales afin d’extrader les personnes (ou les choses) suspectes d’être infectées. Les évêques ont, quant à eux, la faculté d’extraire les laïcs suspects d’être pestiférés et réfugiés dans les églises, afin de les conduire dans les lazarets pour qu’ils y passent leur mise en quarantaine. Ce déplacement de force ne peut intervenir qu’après publication des restrictions de déplacement causées par le temps de la peste. Le privilège est octroyé aux évêques des cités les plus concernées, comme Malte (1644), Naples ou Milan (1657).
Les précisions de Benoît XIV
Benoît XIV (1740-1758) apporte d’autres éléments, notamment au sujet de la messe. La question s’est posée assez vite de savoir si les curés sont tenus d’administrer l’eucharistie aux personnes infectées. Deux réponses contraires sont apportées par les docteurs. La première est qu’ils n’y sont pas obligés, surtout quand leur vie en dépend. Leur vie est plus précieuse et leur santé est requise tant pour les autres sacrements (baptême, pénitence) que pour distribuer la communion aux autres fidèles, non atteints. L’utilité est certes grande d’administrer l’eucharistie, mais prendre un tel risque n’est pas nécessaire. Telle est l’opinion de John Mair, Andrea Molfese ou Antonino Diana. À l’inverse, un plus grand nombre de théologiens de l’époque moderne (Suarez, Lugo, Villalobos, Cardenas, Mazzolini da Prierio, etc.) estime que le curé est tenu, soit par lui-même soit par autrui, d’administrer l’eucharistie à tous ceux qui le demandent licitement, même aux infectés, car « ils ont droit de la demander, et sont en grave nécessité spirituelle de la recevoir, bien qu’ils aient déjà reçu le sacrement de pénitence » (5).
Le pape Lambertini prend le parti de la nécessité contre celui de l’utilité, et loue l’héroïsme de saint Charles Borromée qui donnait lui-même la communion aux pestiférés. Tout en soulignant la rectitude doctrinale de ses conciles provinciaux, il suggère néanmoins de s’en écarter sur le point précis de l’administration de la communion ou du viatique. Le saint évêque interdisait toute nouveauté dans la distribution de la communion, quand le pape explique, dans son traité sur les synodes diocésains (qui n’est donc pas un acte magistériel), que cette loi propre à la province milanaise peut recevoir des tempéraments en temps de peste. Il rapporte une réponse adressée au vicaire apostolique d’Algérie qu’en cas d’épidémie, tous les rites de l’administration de l’eucharistie ne sont pas à suivre, laissant à l’évêque le soin de préciser ce qui peut être omis tout en conservant la décence requise. Là encore, il s’agit d’éviter la contagion et de rendre la communion la moins périlleuse possible. Parmi les moyens imaginés mais réprouvés, Benoît XIV mentionne l’insertion de l’hostie dans du pain ordinaire, ou entre deux hosties non consacrées, l’utilisation d’une pince pour porter l’hostie en bouche ou encore le port de gants.
D’autres moyens sont approuvés, comme le fait de déposer l’hostie sur une crédence décemment préparée pour que le malade, une fois le prêtre éloigné, se communie en consommant les espèces, ou le fait de plonger l’hostie dans un verre d’eau ou de vin non consacré. Il rapporte même l’opinion de certains théologiens (Suarez) affirmant qu’en cas de peste, les laïcs pourraient s’administrer directement la communion dans leurs mains, nues pour les hommes, recouvertes du dominicale (tissu de lin blanc) pour les femmes, selon les consignes de l’ordinaire. Il préfère toutefois l’opinion de Cajetan estimant que le prêtre peut déposer l’hostie sur une patène ou un linge afin que le communiant approche sa bouche pour l’ingurgiter.
De la même manière, l’extrême-onction peut être réalisée en employant non plus la main, mais une baguette dont l’extrémité est constituée d’un coton imbibé d’huile des infirmes. Il en va de même pour la confirmation, qui peut de plus se réduire au rite essentiel décrit dans le pontifical, en omettant les rites annexes.
Aujourd’hui comme hier, les calamités du temps forcent parfois le droit canonique à subir des infléchissements, des dérogations, des suspensions, toujours temporaires, encadrées et respectueuses des sacrements. Cela est totalement conforme à sa mission, le salut des âmes, et répond en temps de crise à l’objurgation de saint Paul : « La charité du Christ nous presse ! » (2 Co 5, 14).
1. J.-N. Biraben, « Peste et papauté », in Ph. Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, 1994, p. 1319.
2. G. Mollat, Les Papes d’Avignon (1305-1378), Paris, 1930, p. 87-88.
3. L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, Venise, 1782, t. 3, v° Extrema unctio, n°43, p. 535.
4. Par infusion : c’est-à-dire en versant l’eau sur la tête de l’enfant.
5. L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, Venise, 1782, t. 7, v° Pestis, n°8, p. 148.











