Article rédigé par Pierre-Henri d’Argenson pour Liberté Politique, le 20 novembre 2020
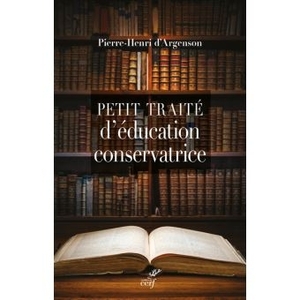
Source [Pierre-Henri d'Argenson pour Liberté Politique] Au beau milieu des ruines du post-modernisme, le conservatisme échoue aujourd’hui à convertir les cœurs, c’est une réalité douloureuse mais indubitable. Sept péchés capitaux expliquent cet état de fait : autant de pistes pour rebondir, afin, par l’éducation, de faire de nos enfants non des gardiens d’un phare dont la lumière s’éteint, mais des conquérants à la tête du navire.
Retrouvez l'intégralité de l'article dans le dernier numéro de la revue Transmettre, entre culture et morale
Lorsque j’ai été sollicité par Liberté Politique pour écrire un article sur l’éducation, j’ai d’abord songé à me livrer à un exercice somme toute assez classique de promotion des piliers traditionnels d’une éducation ancrée, morale et cultivée, en un mot « conservatrice ». Comme dans un programme politique, chacun y aurait sûrement trouvé son compte, gardant ce qui lui convenait et fermant les yeux sur le reste. C’est généralement ce que nous faisons de nos lectures en matière éducative, dans lesquelles nous recherchons plus souvent de quoi nous conforter dans nos pratiques que des réflexions acérées susceptibles de bouleverser nos certitudes. L’éducation obéit en effet, en dépit de son apparence construite, choisie, pensée, au viscéral, parce qu’elle emprunte les chemins tortueux de l’inconscient et qu’elle nous confronte aux soubassements tragiques de l’existence : la mort, la chaîne des générations qui pourrait s’interrompre, nos croyances les plus intimes, la survie de ce que nous sommes à travers nos enfants, tant au niveau de nos individualités qu’à l’échelle du groupe : famille, communauté, nation, religion, culture, langue, civilisation. En un mot, éduquer ses enfants, c’est préparer non seulement notre disparition, mais également la leur. Eux aussi perçoivent, dans nos efforts de transmission, qu’il ne s’agit pas seulement de les aimer, de les faire « grandir », de les doter de qualités de toutes sortes, mais de les initier, dès leur plus jeune âge, à cette fonction de passeur que nous leur demandons implicitement d’être un jour à leur tour. Ils en seront marqués à vie. Cette imprégnation de ce que nous avons reçu de nos parents durant nos jeunes années est si forte qu’il me semble qu’une éducation se fait toujours en miroir, non pas de ce que nous sommes devenus en tant qu’adultes, mais de ce que nous avons vécu en tant qu’enfants, que ce soit pour le reproduire, l’adapter ou le rejeter. Les forces en jeu sont puissantes, et ne se laissent pas aisément manipuler par le discours, qui ne touche en première intention que la partie cérébrale, et donc superficielle, de l’être.
Je m’abstiendrai donc d’un propos attendu sur l’éducation « conservatrice », auquel je me suis déjà livré dans un livre sur le sujet, et qui ne ferait, au mieux, que susciter l’approbation polie d’un lectorat déjà convaincu, sans toucher ceux qui gagneraient à l’être, et qui a en outre le tort d’entretenir, lorsqu’il est répété trop souvent, l’idée bien confortable qu’il existerait deux mondes : celui de la société contemporaine, corrompue, délitée, contaminée chaque jour un peu plus par le progressisme sous toutes ses formes, et celui de la résistance éducative, culturelle voire religieuse, le camp des Saints en quelque sorte, fort assiégé au milieu d’un monde se déchristianisant à vue d’œil après avoir consciencieusement sabordé tous les piliers de la cohésion sociale. Je dis confortable, parce qu’un tel constat, qui n’est d’ailleurs pas fondamentalement erroné, occulte la question désagréable que l’on devrait se poser devant un tel état de fait : pourquoi le « conservatisme » a-t-il à ce point échoué dans l’ordre politique et sociétal ? C’est en répondant à cette question que l’on pourra utilement discerner à quoi éduquer, « conservativement parlant », dans un monde en crise.
On pourrait longuement débattre sur ce que j’entends ici par conservatisme, et sans prétendre mettre tout le monde d’accord, il me parait pouvoir être défini de la manière suivante : un consensus social fondé sur la préservation et la promotion d’une société structurée par la famille, l’institution du mariage, l’amour de la patrie, la souveraineté, l’autorité, la responsabilité individuelle, le service, le civisme (la vertu, diraient les Romains ou Confucius), le sens moral, une charité réfléchie et une certaine décence commune. On pourrait y ajouter l’attachement aux racines, au monde rural, et à la liberté au sens classique, c’est-à-dire celle de faire ce qui ne nuit pas à autrui et de disposer de sa conscience et de sa parole. En miroir, le progressisme pourrait se définir comme une force de déconstruction permanente de tout cela. Un « conservateur » n’a pas nécessairement la prétention d’être absolument exemplaire sur chacun de ces points, mais, à supposer par exemple qu’il ait été conduit au divorce, il n’en déduira pas forcément que la loi doive à tout prix le faciliter, là où un « progressiste » estimera au contraire que la loi doit se conformer à toutes les configurations désirées par les individus. Quant à la « crise » dont je parle, sa caractérisation est évidemment sous-tendue par un parti-pris : celui d’estimer qu’elle est largement liée à la victoire écrasante du « progressisme » dans à peu près tous les domaines qu’il a ciblés, même si elle n’est pas aussi totale qu’elle n’en a l’air, victoire qui s’est traduite par la désagrégation de tous les cadres structurants, non pas tant de la société « d’avant », qui n’était pas plus morale qu’aujourd’hui, mais de toute société (nation, famille, éducation, culture, civisme), les plus modestes étant les premiers à en pâtir.
J’en viens au fond de mon propos : si le conservatisme a, au moins temporairement, perdu, c’est parce qu’il a commis, à mon humble avis, sept « péchés capitaux », dont la bonne appréhension peut nous guider dans la définition d’une éducation conservatrice adaptée aux défis de notre temps et à même de doter nos enfants des outils leur permettant d’y agir, et pas seulement d’y survivre. Le mea culpa étant en outre de tradition chrétienne, il entre parfaitement dans le cadre d’une pensée conservatrice – le progressisme ne s’accusant jamais de rien, puisqu’il est convaincu d’être du côté du Bien, là où le conservatisme recherche, c’est du moins l’idée que je m’en fais, ce qu’il croit être bon.
Son premier péché est la réaction, précisément la réaction politique. Le conservatisme reste, à des degrés divers, inconsciemment habité par l’idée contre-révolutionnaire de Joseph de Maistre et Louis de Bonald que l’homme n’aurait jamais dû devenir souverain à la place de Dieu – en cela ils faisaient une analyse correcte de la Révolution française, à savoir une révolution théologique autant que politique. Il est évident que le progressisme tel que nous pouvons l’observer aujourd’hui, qui s’exprime, entre autres, dans le projet transhumaniste de réduire l’homme à une pure performance biologique et neuronale, guidé par son seul désir, autosuffisant et autojustifié, argile vierge qu’il pourrait modeler à sa convenance en écartant toute histoire, tout devoir, tout lien non « désiré », constitue le prolongement ultime et naturel de la déification de l’homme engagée par le mouvement des Lumières. Pour autant, on ne reviendra pas en arrière, et pour une raison simple : que l’homme soit en mesure de façonner son destin, de choisir ses lois, de donner toute la mesure de son intelligence est aussi la conséquence chrétienne du libre-arbitre. Ou l’homme est libre, ou il ne l’est pas. La liberté, comme chacun sait, ne consiste pas à faire ce que l’on veut, ni à se défier, par principe, de ce que la religion peut apporter comme cadre à l’existence humaine et comme réponse aux questions ultimes (ou l’inverse, selon les traditions). Mais aucun projet conservateur ne saurait prospérer s’il a pour ressort le fantasme de la restauration d’un ordre ancien, ou plus exactement, s’il confond le rêve d’un royaume idéal, qu’il est sain de posséder au fond de soi et qui est seul à même de protéger l’humanité des « ordres nouveaux » de toutes sortes, avec un projet politique uniquement convaincu de la supériorité de l’ « avant ». Il y a peut-être là un deuil à faire, mais un deuil salutaire. L’histoire humaine n’est ni une chute interminable, ni un progrès sans fin. Alors bien sûr, il faut savoir vers quoi l’on va. Et c’est là que le conservatisme a son mot à dire, qu’il a son rôle à jouer. L’essence du conservatisme, c’est de chercher à retrouver ce qui fut toujours perdu, et non ce qui fut perdu un jour. C’est en cela qu’il est une force transformatrice et non réactionnaire. Sa boussole est un intemporel dont nulle époque et nul régime n’a eu le monopole – et c’est pour cela qu’il est à rechercher et non à restaurer. Il est caché au fond de nous et non dans le grenier, enfoui dans notre cœur et non sous le grand chêne. En termes d’éducation, cela implique d’élever nos enfants dans l’amour du monde dans lequel ils vivent, avec tous ses défauts, en leur donnant pour tâche d’en faire un monde meilleur et non un monde d’avant. Nos soldats qui risquent leur vie pour la France ne le font ni pour Charles X, ni pour Charles de Gaulle, mais pour la société dans laquelle ils vivent, pour celles et ceux qu’ils regardent comme leurs compatriotes d’aujourd’hui, avec au fond du cœur cet idéal, qui se construit dans l’enfance, que le héros a pour mission de rétablir la paix et la justice – et non, par exemple, l’alliance du trône et de l’autel.