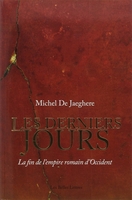Article rédigé par Michel De Jaeghere, le 06 mars 2015

Michel De Jaeghere, directeur de la rédaction du "Figaro Histoire", est l’auteur d’une remarquable synthèse sur La fin de l’Empire romain d’Occident parue aux éditions des Belles lettres. Dans son livre, Les Derniers jours, il expose l’engrenage qui a conduit Rome à armer le bras des barbares.
Liberté politique. – Votre livre s’oppose à la tendance dominante chez les historiens contemporains à minimiser le rôle des barbares dans la disparition de l’Empire romain d’Occident. Quelle a été l’évolution de l’historiographie sur ce sujet depuis Déclin et chute de l’Empire romain d’Edward Gibbon au XVIIIe siècle ?
Michel De Jaeghere. – Imprégné de la poésie des ruines, le livre d’Edward Gibbon est d’une grande qualité littéraire. Il a été fondateur d’une tradition qui a duré jusqu’à la fin du XIXe siècle aussi bien dans l’historiographie que dans la peinture d’histoire : celle des Romains de la Décadence, pour reprendre le titre du tableau de Thomas Couture, romains qui auraient attendu, alanguis, sans réagir, les invasions barbares, entre orgies, jeux du cirque et disputes théologiques.
Gibbon entendait répondre à Le Nain de Tillemont, un historien janséniste du XVIIe siècle qui avait réalisé, dans son Histoire des empereurs la première tentative de synthèse historique des sources littéraires grecques et latines sur la fin de l’empire romain, en les revisitant à la lumière du providentialisme chrétien. Gibbon lui opposait, dans l’esprit des Lumières, un rationalisme teinté d’un fort antichristianisme. À la suite de Voltaire, il désignait en effet le christianisme comme la cause essentielle de la perte d’énergie vitale et des divisions internes qui auraient miné l’Empire romain et l’auraient conduit à sa perte.
À la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe, cette explication a commencé à être contestée et les historiens ont successivement mis en avant des facteurs politiques, économiques, sociaux, militaires, climatiques, fiscaux… et bien d’autres. Un savant allemand a recensé jusqu’à 210 causes avancées comme explications de la chute de l’empire romain, les historiens se séparant pour l’essentiel en deux écoles : ceux pour qui l’empire était mort de ses faiblesses internes, et ceux pour qui il avait, selon le mot d’André Piganiol, été « assassiné » par les envahisseurs barbares.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand historien catholique Henri-Irénée Marrou a renouvelé les termes du débat en soulignant que le dédain dans lequel était tenu, depuis la Renaissance, le IVe siècle, celui de Constantin, trouvait lui-même, originellement, sa source dans la haine du christianisme, le rejet de tout ce qui est chrétien, bien plus que dans l’analyse sereine des témoignages littéraires, artistiques ou archéologiques.
Rejetant le terme de « Bas empire » au profit de celui d’« Antiquité tardive », il a montré que loin de marquer une étape décisive d’une inéluctable décadence de Rome, ce siècle avait été le théâtre d’une renaissance observable aussi bien dans la littérature, avec les Pères de l’Église (saint Jean Chrysostome, saint Jérôme, saint Augustin), que dans l’art, avec le renouvellement des formes gréco-romaines, l’essor de la mosaïque, ou l’architecture des grandes basiliques constantiniennes ; dans la technique, avec l’apparition du moulin à eau ; dans la diffusion de la culture, avec l’apparition du codex (notre livre, facilement consultable) succédant heureusement au volumen.
Durant les années qui ont suivi, l’historiographie dominante, que le discrédit de « l’histoire bataille » conduit parfois à s’affranchir quelque peu de la chronologie, a fini par étendre le bénéfice de cette réhabilitation non seulement au Ve siècle, siècle des invasions, mais aux VIe et VIIe siècles, en mettant en avant la survie de nombreuses pratiques, coutumes, et institutions romaines après la disparition de l’empire romain d’Occident. Dans un essai novateur, paru en 1971, Peter Brown avait montré la voie en englobant comme un même et unique objet d’étude Le Monde de Marc Aurèle à Mahomet. Dans son sillage, l’historiographie récente en est peu à peu venue à nier le caractère décisif de la disparition des institutions politiques de l’empire. À lui préférer l’idée qu’une « immigration salutaire » et des accommodements successifs avec les barbares auraient débouché, presque pacifiquement, sur l’avènement d’une nouvelle forme, nullement inférieure, de la romanité en Occident.
Sans revenir à la vision romantique du XIXe siècle, mon livre remet en cause cette vision des choses en revenant, par le récit des évènements, aux faits : loin de cette vision irénique, la réalité que les sources laissent entrevoir est celle d’une crise violente, débouchant en un peu plus d’un siècle sur un effondrement de la civilisation.
« C’est une utopie de vouloir construire une zone de prospérité entourée d’une zone d’anarchie »
Vous n’avez pas prononcé un mot qu’on associe immédiatement à la fin de l’Empire romain. C’est celui de décadence. L’utilise-t-on à tort ?
Ce terme peut donner le sentiment qu’un mouvement irrésistible a emporté le monde romain vers le chaos, alors que la période considérée a été en réalité le théâtre de déclins et de redressements successifs.
Il évoque en outre une perte d’énergie et un déclin moral considérés comme autant de causes décisives de la crise politique et militaire : une vision qui s’appuie certes sur certaines sources littéraires (Ammien Marcellin, Salvien) mais qui ne correspond pas aux caractères du temps. On trouve, à cette époque, des figures d’une énergie impressionnante, comme Stilicon ou Aetius, des empereurs d’une haute moralité, comme Théodose II, ou d’un dévouement absolu au bien commun, comme Majorien. Les passages des Histoires d’Ammien Marcellin qui mettent en scène une élite de parvenus, un peuple abruti par la passion des jeux sont, pour l’essentiel, des exercices de style visant à l’imitation de Juvénal, qui avait lancé le thème dans ses Satires, au tout début du IIe siècle après J.-C, soit à l’apogée de l’empire romain ! L’idée que les ancêtres étaient plus probes, plus sobres et plus énergiques que les contemporains est un thème réactionnaire qui parcourt toute la littérature latine.
Le livre de Salvien (Du Gouvernement de Dieu) est quant à lui un pamphlet d’une rare violence, qui vise à montrer que les invasions relèvent d’un châtiment divin pour les vices des romains. On ne peut pas prendre toutes ses affirmations pour argent comptant.
Vous semblez considérer l’opposition entre les causes internes et les causes externes pour expliquer la fin de l’Empire romain d’Occident comme un faux débat. De quoi, alors, cet empire est-il mort ?
Il me semble que toute recherche d’une cause unique, en histoire, débouche sur une impasse. L’Empire romain est mort du fait de ce que Paul Veyne appelle une « concaténation de causes multiples ». Certaines relèvent des circonstances, d’autres de ses faiblesses internes, certaines de causes profondes, d’autres du hasard ou de la malchance. Ce que l’on peut reconstituer, c’est seulement l’engrenage qui l’a conduit à une situation où il n’y avait pour lui plus d’issue, et pour ses dirigeants, plus de bonne solution.
Cet empire multinational avait été constitué par la conquête, qui avait permis à la fois de financer l’expansion (par le pillage des nouvelles annexions) et d’apporter à tous la paix et la prospérité en réservant à Rome le monopole de la guerre. Or au IIe siècle, Hadrien avait décidé d’arrêter cette conquête. Rome avait renoncé à la colonisation de l’immense forêt germanique, parce que celle-ci aurait demandé un effort (humain et financier) immense sans offrir de perspective de butin. La décision (que Marc Aurèle, puis Septime Sévère envisagèrent, un temps, de remettre plus tard en question) allait avoir des conséquences considérables. Parce que Rome n’avait pas arrêté son expansion à la frontière d’une autre puissance, avec laquelle elle aurait pu établir des relations, à laquelle elle aurait pu, à l’occasion faire parfois la guerre, mais conclure d’autres fois la paix, mais avec une zone livrée au chaos.
S’il y a une leçon, à tirer de cette histoire, c’est qu’il est utopique de prétendre préserver une zone de prospérité entourée d’une zone d’anarchie. Parce qu’avec les populations qui y résident, aucun accord, aucun partenariat ne sera jamais possible, faute d’interlocuteur indiscutable. Parce qu’aussi, ces populations, vivant dans la misère, seront toujours irrésistiblement attirées par la perspective de franchir la frontière pour jouir des bénéfices de la civilisation sans avoir consenti aux disciplines qui ont permis de la produire.
Parce qu’enfin, comme Fustel de Coulanges a été le premier à le comprendre, les sociétés barbares sont pour les sociétés civilisées des adversaires redoutables, en dépit de la différence de leurs niveaux de développement, car les barbares consacrent toute leur énergie à la guerre, quand les sociétés civilisées ne consacrent qu’une petite partie de celle-ci à leur défense. On estime que de 100 000 personnes (femmes et enfants compris), les barbares tiraient 20 000 combattants (1 sur 5). Dans l’Empire romain du Ve siècle, dont les habitants avaient été déshabitués à la guerre (en donnant à tous les habitants de l’Empire la citoyenneté romaine, l’édit de Caracalla avait fait perdre depuis 212 tout attrait à la carrière militaire, qui était jusqu’alors l’un des principaux moyens de devenir citoyen romain), et où l’économie et l’alimentation de la population reposaient sur la culture de la terre (qui avait besoin de bras, compte tenu du caractère encore rudimentaire des techniques agricoles), la proportion n’était que de 1 pour 400.
Compte tenu de la morosité (ancienne) de la démographie romaine, cette disproportion mettait, paradoxalement, l’Empire en position de faiblesse face à des envahisseurs dont le nombre n’était pourtant pas considérable (sans doute guère plus d’un million, face à un Occident peuplé de plus de 20 millions d’habitants). Elle n’a pas été compensée par un élan patriotique débouchant sur une « levée en masse » du fait du caractère particulier du patriotisme romain.
Un empire multinational (l’histoire en donne d’autres exemples) ne vaut rien en défense. Il n’est pas en effet une simple dilatation de la Cité, tels que le sont les royaumes et les nations. L’adhésion qu’il suscite n’a pas de caractère sentimental, comme celui qui peut s’attacher à la défense de la terre des pères. Il repose sur la promesse de prospérité et de paix : il n’est pas étonnant qu’il s’étiole quand elles disparaissent. Un habitant du Nord de la Bretagne n’avait guère de raison d’accepter de sacrifier sa vie pour défendre la frontière danubienne, alors qu’il l’aurait peut-être donné sans réfléchir pour son village.
« Pour survivre, il aurait fallu que Rome ait les moyens de conquérir la forêt germanique »
La chute de Rome était donc inéluctable ?
Conçu pour la conquête, l’Empire n’était pas maître d’arrêter son expansion, sauf à appuyer sa frontière sur celle d’un autre empire. Au Sud, il était protégé par le désert ; à l’Est, il faisait face aux Perses, auxquels il faisait alternativement la guerre et la paix sans que cela mette en question plus que le tracé exact des frontières et les zones d’influence (pendant des siècles, l’Empire parthe, devenu au IIIe siècle l’Empire perse a été considéré comme l’ennemi numéro 1 de l’Empire romain. Or il est significatif que ce ne soit pas lui qui ait provoqué sa chute : en Occident, l’Empire est tombé sous le coup des barbares et en Orient il perdra ses provinces proche-orientales et nord-africaines de la main des cavaliers arabes.
Le problème se situe au Nord-Est. La forêt germanique est un monde infini : Rome n’aurait pu survivre qu’en le conquérant. La tâche était surhumaine, et sans doute au-dessus des moyens dont disposaient les Romains. Il aurait fallu des armées et des fonds considérables pour occuper et exploiter les terres conquises et faire peu à peu des barbares des loyaux sujets de l’Empire romain. Cela aurait supposé que des progrès techniques assurent aux terres de meilleurs rendements afin d’augmenter les rentrées fiscales et de favoriser une reprise significative de la natalité dans le monde romain.
Faute d’armées, faute d’argent, les empereurs du IVe siècle ont essayé de surmonter la difficulté en créant au-delà du Danube et du Rhin une chaine de royaumes-clients qui gardent les frontières pour leur compte. Cela s’est d’abord révélé efficace, mais ces royaumes se sont effondrés à la fin du siècle sous la pression exercée sur eux par l’avancée des Huns. Dans le même temps, les barbares avaient constitué, sous l’influence et par imitation de l’Empire, avec lequel ils avaient multiplié les contacts, des confédérations qui les rendaient capables d’affronter victorieusement une armée romaine.
Les empereurs n’eurent plus dès lors de bonnes solutions : ils se résolurent à accueillir sur leur sol les barbares qui fuyaient devant les Huns, ou au moins à les accepter, après qu’ils y eurent fait irruption, en faisant d’eux, de l’intérieur, des auxiliaires et des gardes-frontières. C’était enfermer l’empire dans un cercle vicieux en remettant son sort à des adversaires qui n’avaient pas été vaincus sur le terrain, piège d’autant plus infernal qu’on renonçait en même temps à ce qui avait permis de tout temps aux Romains de s’associer les peuples dont elle avait fait la conquête en leur imposant une progressive romanisation.
« Après avoir renoncé à la conquête, Rome renonce à la romanisation »
Pourquoi Rome a-t-elle renoncé à la romanisation, et en quoi consistait-elle ?
La barbarie était, aux yeux des Romains un état transitoire, liée à la vie tribale. On pouvait en sortir en entrant dans la vie civique. Le civilisé est celui qui vit dans une cité définie par un territoire, une frontière, et régie par des institutions délibératives où la raison prévaut sur la passion.
En Orient, Rome avait respecté l’autonomie des cités hellénistiques, auxquelles elle avait laissé la liberté de s’administrer elles-mêmes, ne se réservant que la sécurité, la justice, la diplomatie et la guerre. En Occident, elle avait imposé la vie civique aux peuples qu’elle avait vaincus en substituant des cités aux anciennes tribus. Chacune d’entre elles avait eu à cœur de doter son chef-lieu de temples, de basiliques, d’aqueducs, de thermes, qui faisaient d’eux une imitation de Rome, et favorisaient l’adoption progressive des mœurs romaines. Sans faire disparaître les identités locales, Rome avait en outre encouragé la diffusion de la langue et de la littérature latines par la mise en place d’un réseau d’écoles.
Cette politique avait assuré l’assimilation des vaincus, leur association au destin collectif des Romains. Dans l’urgence qui préside, à la fin du IVe et au Ve siècles, à l’accueil contraint et forcé de populations barbares, elle est abandonnée au profit de l’installation d’enclaves étrangères dont on a respecté les structures tribales. Au lieu de disperser les barbares pour qu’ils se fondent dans la population, on les accepte en masse en respectant leurs hiérarchies traditionnelles parce qu’on compte sur leur chefs pour les mener, au besoin, à la guerre pour le compte des Romains.
Après avoir renoncé à la conquête, Rome renonce ainsi à cette romanisation qui était l’un de ses plus anciens principes de gouvernement. Miné par la présence de ce qui va peu à peu devenir des principautés barbares autonomes, l’Empire n’aura bientôt plus d’autre recours que d’utiliser ces barbares les uns contre les autres, en redoutant tout autant leur défaite que leur victoire complète, qui mettrait son gouvernement sous la coupe d’alliés disposant du monopole de la force.
C’était s’enfermer dans un engrenage qui ne pouvait manquer de le condamner, à terme, à la dislocation.
Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Illustration : Thomas Couture, Les Romains de la décadence (1847), Musée d’Orsay.
LA FIN D'UN MONDEDans Les Derniers jours : la fin de l’Empire romain d’Occident, Michel De Jaeghere effectue une minutieuse autopsie d’un empire qui pacifia le pourtour méditerranéen. Les conclusions de l’auteur sont autant d’alertes pour ses contemporains. Michel De Jaeghere prévient d’emblée son lecteur. La fin de l’Empire romain d’Occident est « à elle seule une leçon de science politique ». Dans ce livre d’une extrême précision [1] — ce qui le rend parfois difficile —, la chronologie, les cartes, les sources littéraires, les travaux d’historiens et d’archéologues sont mis au service d’une explication des faits, c’est-à-dire des mécanismes qui au-delà de la chute de Rome nous enseigne sur la mort des empires. C’est une véritable enquête, dont le mot « histoire » tient son étymologie, à laquelle s’est livré l’auteur. À rebours de l’historiographie récente, qui tend à réduire l’importance qu’a constituée la fin de l’Empire romain d’Occident, synonyme de la fragmentation en royaumes de l’unité forgée par les armes et les lettres autour du bassin méditerranéen, Michel De Jaeghere inscrit ses pas dans ceux de l’historien Aldo Schiavone :
La romanitéLes Romains, héritiers de la pensée grecque, assimilaient eux même merveilleusement les populations conquises en associant leurs élites à sa civilisation. La rivalité entre les cités (mot qui donnera d’ailleurs civilisation) grecques rendait impossible la stabilité nécessaire au plein épanouissement de l’hellénisme. La pax romana et une certaine idée de la citoyenneté ont permis à celui-ci de sortir de l’état de barbarie les peuples conquis par les armées républicaines et impériales. Les bienfaits matériels apportés aux populations par la colonisation romaine sont également de première importance. Michel De Jaeghere, citant l’archéologue Bryan Ward Perkins, souligne ainsi qu’aux fermes en pierre et aux villas avec eau chaude se sont substitués après la chute de l’Empire des habitats en bois avec des toits en chaume. Les routes par lesquels Rome avait assuré sa puissance sont également détruites par un morcellement anarchique des territoires. C’est grâce à ces apports matériels et civilisationnels de la Romanité qu’aucun particularisme national ne s’est éveillé au cours de la chute de l’Empire romain. Le christianisme n’est pas non plus en cause en ceci qu’il a apporté au IVe siècle un renouveau des arts et des lettres latines. Les chrétiens qui refusaient de porter les armes avaient été excommuniés par le concile d’Arles, et les Pères de l’Eglise, patriotes, estimaient que les destins de l’Empire romain et du christianisme étaient liés. Le cercle infernalPris dans un cercle infernal, où démographie déclinante, perte de l’esprit militaire, économie peu productive et menace barbares (interne et externe) se renforcent l’un l’autre, Rome a été contrainte de mener la politique du moindre mal, en monnayant la paix (territoires, argent) avec les barbares jusqu’à en payer le prix. À l’image du nazirite Samson dont la force apparente s’est avérée faiblesse : « Du fort est sorti ce qui est doux et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. » Toute une civilisation s’est effondrée avec l’Empire d’Occident tandis que son voisin d’Orient, protégé des usurpateurs par sa tradition monarchique et des barbares par sa géographie, renouait avec l’hellénisme. Si l’auteur se garde de dresser explicitement des parallèles avec notre époque, ceux-ci apparaîtront clairement aux lecteurs tant sont frappantes les analogies, qu’il s’agisse de politique d’immigration, de politique étrangère ou encore de démographie. L’histoire de la chute de l’Empire romain d’Occident, écrit Michel De Jaeghere en conclusion de son livre, est pour nous un avertissement. Laurent Ottavi
Les Derniers Jours : La fin de l'Empire romain d'Occident
|
[1] Michel de Jaeghere est à la fois historien et juriste de formation, son livre est le résultat de quinze ans de travail.
***