Nos coups de coeur
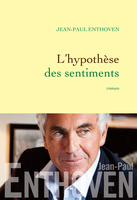
En guise d’entrée en matière – celle des chatoiements des sens, des atermoiements des humeurs en quoi consistent les malheurs et les bonheurs qui composent le quotidien du sensualiste [1] – et comme un voile de tulle posé sur les plateaux d’une balance d’apothicaire, voici une thèse élaborée, ainsi que l’auteur semble s’en avoir fait le serment, avec l’élégance de celui qui mène droit ses pensées, cependant avec subtilité.
La bande-annonce où il s’illustre et en laquelle, à l’analyse, le livre trouve et son commencement et sa fin, campe un hédoniste, pas un épicurien, avisant sa proie lors d’un dîner Et, puisque nous ne croyons guère que le profil qu’affiche notre carnassière première dame de l’Etat fusse celui qu’il affectionna et désira, Jean-Paul Enthoven inscrit à notre menu une Marion, héroïne de second plan, «divine meringue» qu’on imagine en effet en robe du soir ou en déshabillé blanc-crème. Passablement cérébrale, toute en recherche d’elle-même, rêvant d’Anna Karénine, à ce point belle et raffinée que la sagacité d’un Enthoven psychologue et salace ne puisse exclure de ne nous la livrer en pâture, à nous lecteurs, pour des assauts profanateurs, Marion sera ainsi l’alambic autour duquel il formulera ses hypothèses, vérifiera ou pas thèses et antithèses, expérimentera une synthèse amoureuse que l’homme de chair et d’esprit sait bien de toute éternité n’être proclamée qu’à tort introuvable.
Notre meringue va-t-elle s’effriter ? Ou, autour de la friandise, une cristallisation finira-t-elle par opérer ? L’alchimiste doit alors se faire metteur en scène. Au volant d’une Mercedes intérieur cuir à injection, on court ainsi de Monte-Carlo à Paris, en passant par l’Italie. L’avions-nous signalé ? Enthoven travaille au corps son texte avec la politesse et le savoir-faire (à moins que ce ne soit l’inverse) de ne le laisser nullement paraître. A l’image d’un acteur qui sait qu’il ne doit que par exception dévoiler son jeu, sous cette permanente délicatesse de la forme et du fond déroule-t-il des considérations de facture autant littéraire (avec Stendhal à la proue, Montherlant à la poupe, comme page 283) que sociologique (le nom dont use la gauche en lieu de ‘‘politique’’). Il n’est jusqu’à la mention de cette prévention contra-sémite de salons, relevée par son double, Max Mills, qu’il ne susse amener dans une lancée dont nous ne saurions duverger [2]. A vrai dire, l’intrigue compte peu. L’histoire des deux mallettes rouges malencontreusement échangées à la sortie d’un grand hôtel n’est que le prétexte, déjà en lui-même réjouissant, à des observations frappées au coin d’un sens critique acéré, le prélude à l’apologie d’un présent qui ne mérite d’être vécu que s’il se conjoint à tous les plaisirs (c’est là où, disciple d’Aristippe, Enthoven se fait aussi épicurien). C’est là aussi non la limite de ce roman, mais – osons le mot car c’est en l’espèce bien lui qui convient – sa finitude. Au reste, l’auteur semble le pressentir lorsque, à l’exemple d’une Grace Kelly envoyée valdinguer à la sortie d’un virage par-dessus la corniche, il condamne Marion à la même destinée. C’est une façon, si l’on ose dire, de couper court à des questions d’un autre ordre, de mettre fin, comme un amant habitué à casser, à une histoire qui faisait déjà quatre-cents pages.
De ce livre, nous avons dit peu de choses. C’est toujours le cas lorsqu’il s’agit des choses de la vie débarrassées de l’eau de roses d’un Claude Lelouch. Mais, comme le verbe l’indique, rendre compte n’est guère étudier, moins encore labourer : tout doit tenir en une addition (les qualités de l’œuvre), outre, si besoin est, une soustraction. Editeur de lui-même, distingué sculpteur de sa personne, avant de se mettre à l’ouvrage, Enthoven père s’est mis les points sur les i. En définitive, force est de dire qu’il les a bien écrits. Il a tenu son pari jusqu’à instiller en nous un peu de cette admiration qui jouxte la jalousie tant nous abusons des adverbes et nous savons pertinemment inapte à envisager d’une histoire drôle, et au fond passablement mélancolique, un essai dont la matière même, écrirait Montaigne, ne serait autre que nous-même.
Le fidèle de l’œuvre observera [3] un progrès dans les connaissances astrologiques, même si, quand même, à défaut de situer le Taureau dans Vénus, l’apprenti astrologue attribue à l’occasion des traits de la Vierge aux Gémeaux, et vice-versa. (Par contre [4], la cartomancie est en voie d’assimilation : sous bien des réserves que seuls les initiés pourraient subodorer – c’est l’odeur du souffre - ce neuf de carreau à côté du neuf de pique en fait ‘‘foi’’.) On a beau être dans le roman, les «temples luthériens» (p. 30) ne courent pas la Suisse, ou alors s’agit-il de temples calvinistes. Et, si luthériens il y a, ceux-ci disposeraient d’‘‘églises’’.
Encore sont-ce là simples remarques factuelles qui n’affectent pas un roman aux affects très maîtrisés. Roman fort moral au demeurant, alternant égoïsme et égotisme, atteint in fine, et pour son plus grand bien, d’un tropisme d’altruisme. Ce dont le cœur implacable et érudit de ce libertin déduit : « aime ta prochaine comme toi-même. »
Hubert de Champris
[1] on fait ici aussi allusion à la philosophie sensualiste de Condillac
[2] Au correcteur prêt à bondir qui titille tous bons lecteurs, cette précision : autrefois assistant d’un fameux constitutionnaliste tenu à tort comme l’auteur de l’expression «monarchie républicaine» pour qualifier la Vème République gaullienne (F.-W. Benemy en est à l’origine, cf. Fondation Charles de Gaulle, De Gaulle et la Nation, F.-X. de Guibert, p. 73), l’écrivain s’en éloigna, estimant un peu fort de café qu’il fut cité en témoin de moralité de l’ancien maréchaliste. Là-dessus, il n’y a lieu de diverger.
[3] cf. Ce que nous avons eu de meilleur et, même, Les enfants de Saturne (Grasset)
[4] Les grammairiens divergent sur sa recevabilité ; en revanche semble bénéficier de faveurs indues.















